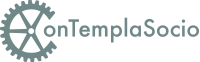Introduction cagoulée
Tout le monde a son K-Way sombre, son bonnet, ses chaussures imperméables à semelles renforcées, sa lampe frontale. Les sacs à dos sont garnis d’eau, de compote en tube et de camembert industriel. Le plus expérimenté a prévu la pince monseigneur de poche et une scie à métaux taille enfants. La veille, j’ai paniqué et envoyé à tout le monde un SMS inquiet : « je n’ai pas de lunettes à visée laser, c’est grave ? » On m’a dit de me détendre. Mais dans quoi s’embarquait-on, le casse du siècle d’un bijoutier de la Place Vendôme, une infiltration dans les serveurs du compte Twitter de Donald Trump ? Vous n’y êtes pas, rien d’aussi lucratif : rien de plus que l’exploration d’un gigantesque site de traitement du charbon dans le bassin minier du Creusot. Lequel, bien qu’inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis sa fermeture en 2000, croupit dans un abandon total depuis plus de quinze ans, et n’ouvre pas ses portes même pour les Journées du Patrimoine. Et ici, une rapide analyse du marché immobilier exclut toute hypothèse qu’Unibail-Rodamco débarque un beau matin pour transformer ces bâtiments en lofts luxueux et galeries marchandes de luxes. Celui qui veut aller voir de plus près à quoi ressemblait la machine industrielle du temps de sa splendeur passée doit traverser les ronces, siffloter d’un air dégagé devant des passants suspicieux et éventuellement escalader quelques grillages, voire enjamber des fenêtres cassées…Faut-il avoir honte quand on veut faire un tour dans ce genre de ruine ? Est-ce moins honorable que de se balader, tête en l’air et moue de « déjà-vu », parmi les vestiges d’un temple antique ?
Peu importe, en tout cas, ça se mérite. Il y a des loisirs plus accessibles que d’autres.
Pénétrer dans des terrains condamnés peut s’avérer périlleux : maîtres-chiens, caméras de vidéosurveillance, grillages sont régulièrement déployés par le vénérable Département de prévention et sécurité minière des Houillères des bassins du centre et du Midi, qui doit empêcher qu’un intrus ne passe à travers un plancher et s’empale malencontreusement sur une armature de métal rouillé. Pour l’explorateur de friches, un autre danger existe, qui peut réduire à néant plusieurs semaines d’efforts d’organisation et de logistique : le riverain derrière son rideau, qui appelle la maréchaussée en constatant qu’une voiture immatriculée hors du département est stationnée à côté d’une entrée, ou en apercevant quatre Rapetou d’opérette trotter et jeter des regards furtifs à droite et à gauche pour enjamber une clôture. Dans les environs d’un site comme celui où nous comptions entrer, en périphérie de la ville, l’activité est proche de celle des faubourgs de Tchernobyl, alors le moindre mouvement éveille l’attention. Détaillons un peu…Vu d’une carte routière, la houillère, située sur un terrain de 35 hectares, est encadrée par : une route départementale qui longe le portail d’entrée principal ; des voies annexes au réseau ferré national ; un petit cours d’eau qui la sépare d’un quartier pavillonnaire où devaient habiter les contremaîtres à la grande époque du bassin minier ; et enfin, plusieurs entrepôts encore en activité entre lesquels chemine une voie goudronnée permettant d’accéder à des parkings.
Entassés à cinq dans une Twingo, excités à la vue du mastodonte de fer et de béton qui se dresse derrière des arbustes, nos regards sont affutés et nous sommes tentés de nous faufiler par un trou dans le grillage situé juste en bordure de route ; mais où garer la voiture sans bâche de camouflage anti-drones un brin parano, sans se faire repérer par les pêcheurs en faction à vingt mètres ? En poussant un peu plus loin, nous nous stationnons dans le lotissement coquet et vieillissant de maisons de pierre de taille avec balcons en fer forgé et jardins propres, le tout noyé dans une bruine désespérante. Quelques voilages aux fenêtres frémissent et un poulailler s’anime à notre passage, mais finalement, beaucoup de frayeur pour rien puisque le sentier qui mène aux entrepôts, prolongé par une voie de service, amène tout droit au site recherché. Sans effraction, ni grillage, ni violence (heureusement), nous pénétrons sur la Terre promise.
L’Etat de Nature
Ainsi donc, au milieu des herbes folles, nous étions jeunes et larges d’épaules, bandits joyeux, insolents et drôles, on fanfaronnait, en quelque sorte, et l’ambiance minière incitait à citer ce bon vieux Nanard Lavilliers. Mais, passées les dernières ronces, on fait moins le malin, face à 8000m² de bâtiments compactés, imbriqués les uns dans et sur les autres, sur une hauteur d’une bonne cinquantaine de mètres.
Au fond, cet amoncellement de rouille pourrait inspirer un nom de groupe de rock, pompeux ou romantique, ou les deux. C’est amusant, quand on y réfléchit, les métaux ont toujours été une référence dans la musique à guitares. Le plomb y a droit avec Leadbelly et Led Zeppelin ; la ferraille toute simple, c’est le papillon d’Iron Butterfly ; le cuivre transpire chez Copperhead, le fer-blanc se retrouve chez le Tin Machine de David Bowie, et même les chimistes les plus avertis trouvent leur bonheur avec le vif-argent, chez les hippies acides de Quicksilver Messenger Service… Sans parler des inénarrables Gold, de Metallica ; même les quatre de Liverpool se sont appelés, à leurs débuts, les Silver Beetles…Paul Bismuth est le nom de scène d’une célèbre barbouze, et il existe probablement un groupe de Metal Hardcore à cheveux longs dénommé Plutonium. Bref, tout le monde y a droit, sauf l’état dégradé, l’oxydation, la rouille ; seul Neil Young nous rappelle que « rust never sleeps ».
La rouille ne meurt jamais, c’est sa malédiction. Elle veille, calme et morne ; c’est ce que nous allons voir.
Il est facile de rester quelques secondes bouche bée, agenouillé, béat, comme face à une gigantesque falaise à pic au détour d’une ballade en vallée. L’impression est similaire à la plupart des sites industriels, entre géant endormi et monstre menaçant, et pourtant, nombreux sont ceux qui décréteront ces monstres de béton et de ferraille moches, sans intérêt…S’il est possible de frimer un peu, on citera Claude Lévi-Strauss qui écrit, dans Tristes Tropiques, quelques lignes à propos de New York et du gigantisme américain, et qui pourront éclairer la lanterne de ceux qui considèrent les adorateurs de friches avec le regard compatissant qu’on accorde aux fous totaux :
« Partout on est saisi par le même choc (…) : d’où provient le sentiment de dépaysement ? Simplement, de ce que le rapport entre la taille de l’homme et celle des choses s’est distendu au point que la commune mesure est exclue. (…) Cette incommensurabilité congénitale de deux mondes pénètre et déforme nos jugements. Ceux qui déclarent New York laide sont seulement victimes d’une illusion de la perception. N’ayant pas encore appris à changer de registre, ils s’obstinent à juger New York comme une ville, et critiquent les avenues, les parcs, les monuments. Et sans doute, objectivement, New York est une ville, mais le spectacle qu’elle propose à la sensibilité européenne est d’un autre ordre de grandeur : celui de nos paysages. (…) La beauté de New York ne tient donc pas à sa nature de ville, mais à sa transposition, pour notre œil inévitable si nous renonçons à nous raidir, de la ville au niveau d’un paysage artificiel où les principes de l’urbanisme ne jouent plus : les seules valeurs significatives étant le velouté de la lumière, la finesse des lointains, les précipices sublimes au pied des gratte-ciel, et des vallées ombreuses parsemées d’automobiles multicolores comme des fleurs. »
Ce n’est plus un bâtiment, ni même un territoire, c’est un massif, c’est l’Uluru…C’est un paysage artificiel. Et tel un écosystème, nous allons pénétrer dans ses grottes sombres où seules poussent quelques brindilles malingres , éviter ses marécages de rouille friable, nous frayer un chemin dans les forêts de tuyauteries insolubles, parcourir les sentiers de grande randonnée, larges et à la douce courbure, où l’on faisait autrefois rouler des wagonnets, tout ça jusqu’au sommet, d’où l’on pourra admirer la canopée primaire et apparemment éternelle, les toits de briques, les couvertures de zinc, qui s’étendent jusqu’à laisser place comme par continuité à la véritable forêt.
Mais le sentiment de nature omniprésent n’est pas uniquement dû à l’énormité des bâtiments, on est vite frappé par la porosité entre l’intérieur et l’extérieur de cette forteresse Le bruit de goutte à goutte de l’eau infiltrée depuis les trous dans la toiture est partout, il compose avec les chants d’oiseaux qui pénètrent depuis les carreaux cassés le tapis sonore de notre exploration, mélangé au tintement métallique de nos pas sur les caillebotis ou les quelques appels au rassemblement pour s’assurer, régulièrement, qu’aucun de nous n’est resté coincé dans une cabine de contremaître.
C’est bien simple, c’est une bataille épique et mythologique, Gaïa est en train de boulotter tout cru les forges d’Héphaïstos. Le niveau bas, deux obscures salles de plus de cinquante mètres de long, ne sont éclairées que par les portes à chaque extrémité et par les ouvertures des tombereaux au-dessus de nos têtes. Sur le côté, le clapotis du canal qui lèche les fondations et d’où partait le charbon trié, calibré, vers la centrale électrique voisine et vers d’autres usages : cet étage inférieur des bâtiments est une véritable champignonnière. Plus haut, au beau milieu de la salle des tapis roulants d’où on criblait une dernière fois, manuellement, la houille, c’est carrément un petit jardin qui se développe avec son filet d’eau, sa mousse vert vif…Les nénuphars ne sont pas loin, sous les poutres treillis qui soutiennent les sheds aux allures de serre. Et partout, la végétation se fraye un chemin, les ronces protègent l’entrée du donjon de la princesse, les fougères prolifèrent dans chaque recoin.
Tous ces éléments font ressortir, par contraste, la marque de l’homme, qui ne surgit que ponctuellement. Les noms des mineurs sur les vestiaires, les boulons restants dans les cases du magasin, les messages de sécurité gravés sur des plaques métalliques (« attention à votre chevelure ; il est interdit de percer sans coiffure de protection » ; « crible des déclassés »), rappellent que pendant des décennies, des centaines de mains y œuvraient chaque jour. Les petits tas sur les côtés des tapis roulants, devant les postes de travail, les photos coquines accrochées dans les toilettes, mais aussi les locomotives stationnées sous un hangar dans la partie haute du site, les gants et uniformes qui laissent penser à une désertion soudaine et paniquée font se souvenir que des hommes ont sué, se sont éreintés, dans cette petite ville, pendant plus de soixante ans. Ici, on poussait littéralement les wagonnets de la mine. Des vies entières, le cliché est communément utilisé mais, dans l’ancienne cantine aux murs gris de suie, ils sont palpables, les fantômes de ces existences de labeur à qui, du jour au lendemain, des gestionnaires ont annoncé gravement qu’il fallait mettre la clé sous la porte.
Attention, pas de parabole du libéralisme sauvage, la fermeture de la houillère n’est pas due à des délocalisations, mais simplement à l’épuisement des carrières. Plus de charbon dans la région, tout bêtement. Il est toutefois intéressant de noter que, dix ans avant la fermeture définitive du site et alors que l’usine ne traitait plus que des résidus des mines déjà fermées, des visionnaires ont eu le flair d’y automatiser la majorité des chaînes de traitement : on imagine d’ici les « géniaux ingénieurs » confiants dans le lendemain et sûrs de dépenser des millions de francs pour donner à leur usine un avenir radieux, et perpétuer ce que les générations précédentes avaient construit.
Alors venons-en au cœur du problème : justement, comment est-ce bâti ?
Le sens de l’Univers
Vu de l’intérieur, pour être honnête, il est compliqué de s’y retrouver. L’architecture, à n’en pas douter, est tout entière orientée vers l’utilisation industrielle du site, mais elle reste peu lisible, y compris pour les austères et cartésiens Shadocks que nous sommes. Les matériaux sont disparates : des structures primaires en fonte, d’autres en béton armé, des remplissages tantôt en brique, tantôt en parpaing…Les planchers sont parfois en caillebotis ajouré, parfois en tôle reposant sur des poutrelles métallique, parfois en dalles de béton, dans un effet de patchwork. Tout cela ne vieillit pas à la même vitesse ni de la même manière, ce qui nécessite de redoubler d’attention à chaque pas et appui : tôle rongée par un goutte à goutte continu sur un palier d’escalier, ciment friable laissant apparaître le vide…Bien sûr, la rigueur de l’architecture met en évidence, de proche en proche, des trames se répétant dans une régularité vertigineuse, des symétries parfaites dans les axes horizontal et vertical…Mais ces répétitions et effets miroir ne fonctionnent qu’à petite échelle, elles ne se reproduisent jamais au niveau de l’usine ou même d’une pièce. La surélévation réalisée vers 1950 dans les travées centrales pour installer un pont roulant est la seule partie de toiture à longs pans alors que toutes les travées d’origine sont munies de sheds, ce qui n’améliore pas la lisibilité de l’ensemble.
Les cheminements, tapis roulants, et gros équipements tels que les cribles, les tambours de décantation, ainsi que les tuyauteries et pompes associées, sont disposées dans les trois dimensions via des assemblages de poutres dignes d’un Meccano géant. Mais là encore, pas de raison apparente pour que des machines similaires soient supportées ici par des profilés IPN, et là par des poutres treillis. Certains éléments de façade mettent en évidence de manière émouvante le soin quasiment artistique que nos anciens savaient apporter à leurs créations, même les plus utilitaristes : la plupart des poteaux de béton armé, même les pilotis situés dans les soubassements, sont octogonaux, comme un rappel du style Art Déco finissant de l’époque de construction (de 1923 à 1927 pour le bâtiment d’origine). De même, un des quais de déchargement a l’allure accueillante et fastueuse d’un porche de maison coloniale, avec de fins poteaux élancés qui semblent former une véranda surélevée protégée par des garde-corps de béton filants, et d’où partent deux escaliers monumentaux symétriques : sans la poussière noire et la bruine glacée, sans les dimensions pharaoniques, on s’attendrait presque à se faire accueillir par un Southern Gentleman de Caroline du Sud, pour boire un thé glacé ou un Mint Julep. Fort bien, mais alors, pourquoi cet effort particulier pour un arrière de bâtiment qui ne sert qu’à livrer des bennes et des bennes de charbon, alors que les petits pavillons administratifs, qui marquent l’entrée du site, n’ont droit à aucun signe distinctif ? Mystère. A moins que ce ne soit un « bonus caché » dédié aux explorateurs de ruine qui passeraient par là un siècle plus tard ?
Si vous cherchez un sens à l’Univers, venez faire un tour dans cette houillère, ça vous détendra.
Prenons de la hauteur, depuis les vestiaires accolés à l’atelier qui forment une mezzanine surplombant le bâtiment des « verses », ou bien depuis la plateforme qui permet d’accéder au toit et d’où on domine les milliers de mètres cubes du bâtiment principal du lavoir. Certes, on distingue quelques bribes d’enchaînement logique qui suivent la gravitation : l’arrivée du charbon par le haut, puis l’écoulement progressif vers le bas au fil de ses traitements jusqu’au niveau des bassins d’eau où des barges récupéraient le produit fini. Ce qui se voit de loin grâce à la géologie du terrain (aménagé pour l’occasion en plusieurs plateaux avec la bagatelle de 3 millions de mètres cubes de remblais), et qui est confirmé dans les process de traitement, en suivant les bandes de caoutchouc encore intactes des convoyeurs à tapis roulant, les enchaînements de petits godets des norias (systèmes à courroie permettant de faire monter du charbon d’un niveau à l’autre) et les points centraux que forment les énormes tambours du bâtiment principal qui reçoivent les plus gros morceaux de houille, ceux qui n’ont pas passé les séries de cribles. Ces gigantesques cylindres où aboutissent des perfusions variées d’eau et de magnétite permettent, par décantation, de séparer le charbon pur du schiste. Restent donc ces quelques grandes lignes, que nous avons réussi à déchiffrer grâce à nos lectures préalables (« Regardez, ce doit être le fameux tambour américain à liqueur dense Wemco installé en 1947 ! ») et grâce au bon état de conservation de bâtiments définitivement fermés depuis plus de quinze ans, puisque seul le cuivre des câbles et des énormes enrouleurs du bâtiment de transformation électrique ont été soigneusement emportés. L’ensemble se dégrade lentement (la rouille ne dort pas, on vous dit), les tuiles tombent, mais la présence de la plupart des chaînes, des équipements, des réseaux, et l’odeur persistante de la graisse dont les rouages sont oints, tout cela laisse penser qu’avec quelques générateurs on pourrait rapidement tout remettre en service.
Ces rares éléments tangibles nous permettent de nous raccrocher à la certitude que ce sont bien des êtres humains qui ont conçu, construit, puis exploité des bâtiments cyclopéens, qui sont même carrément dénommés « vaisseaux » dans les descriptions des architectes des monuments historiques. Pourtant, en s’y promenant, chaque détail remet en question le raisonnement précédent, et jusqu’à notre sens de l’orientation : à un instant on marche sur un terre-plein, et la minute d’après on aperçoit entre nos pieds un trou béant sur une immense salle obscure ou, mieux, sur un autre niveau d’où un acolyte nous fait coucou. Puis on en voit un autre qui semble tout proche alors qu’il est à plus de cinquante mètres.
Il est possible de suivre une piste pendant plusieurs minutes pour, finalement, se retrouver au point de départ. On croit être sous terre en raison de la luminosité qui baisse et des maigres rayons de soleil qui percent trois niveaux de plancher au-dessus de nous ? Passée une porte, on arrive dans une petite pièce incongrue en porte-à-faux d’où on peut admirer les eaux stagnantes d’un canal, à quinze mètres en contrebas…Tout cela perturbe, impossible de savoir si nous sommes aussi étourdis que les deux Dupondt suivant les traces de leur propre Jeep dans le désert de l’Or Noir, ou si nous avons pénétré dans une antre où les règles de la géomètre euclidienne ne s’appliquent plus. Et ces cylindres de deux mètres de long, tous couchés dans la même direction et dans la semi-obscurité, ne ressemblent-ils pas étrangement aux Grands Anciens, ces monstres mythiques que des explorateurs du Pôle Sud découvrent et réveillent dans une vieille histoire de Lovecraft et qui sont plus ou moins les créateurs du Cosmos ? Ce sont peut-être eux qui ont construit ces mastodontes pour extraire le charbon qui les nourrit ? Bigre, mais où est Cthulhu ? Facile de devenir fous dans les boyaux et les organes enchevêtrés et incompréhensibles de ce site…
La tête dans le Cloud
Cependant la raison reprend le dessus, nous devons comprendre. En vain…Tout laisse à penser que quarante bureaux d’étude ont étudié quarante blocs disparates dans leur coin et que, par magie, l’ensemble a engendré, dès sa mise en service en 1930, le site de traitement de charbon le plus moderne et le plus productif d’Europe (1000 tonnes de charbon traité par jour).
En réalité tout a été conçu par un seul cabinet d’ingénieurs, le bureau d’étude Considère-Pelnard-Caquot qui regroupait la crème des avant-gardistes du béton armé de l’époque. Ils en ont défriché les possibilités en même temps que Freyssinet et ont érigé de nombreux ouvrages qui ont battu des records du monde en leur temps. Armand Considère, après s’être frotté à l’exploitation ferroviaire et à la production d’acier, fait partie des pionniers français de ce qu’on appelle encore, en 1900 le ciment armé et participe aux commissions qui en établiront les premières règles de calcul sur la base d’essais en laboratoires…Non sans quelques approximations, puisque les déformations différées du béton dues au fluage de l’eau n’y étaient pas identifiées. On lui doit l’invention du béton fretté et, en 1906, la contribution à la « Cathédrale » de la chocolaterie Menier à Noisiel. Albert Caquot, de quarante ans son cadet, n’est pas le premier venu non plus : le pont La Fayette qui enjambe les voies ferrées de la Gare de l’Est, certainement l’ouvrage le plus laid de tout Paris mais qui reste un exploit technique ; le pont de la Caille à Annecy, un arc unique de 140 mètres de portée ; ah, et aussi la structure interne du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, excusez du peu…
En résumé, ces experts de l’ouvrage d’art plutôt que du bâtiment savaient ce qu’ils faisaient, et en fin de compte, les plans et les coupes, le bon vieux papier mis à disposition par les archives des Monuments Historiques permettent de tout comprendre, en les associant aux témoignages récoltés auprès d’employés et ingénieurs du site. L’organisation entre bâtiments, le cheminement des process, les partis architecturaux…Tout cela a bien été pensé et construit par des êtres humains, en fin de compte. Bigre, mais quel genre de maquette numérique ont-ils utilisé ? Avaient-ils instauré un BIM niveau 3 ? Et quelle était la technologie du cloud de l’usine ? En sortant de là, vers 17h, alors que la lumière commençait à décroître, il fallait se rendre à l’évidence : de même qu’a débuté la post-vérité, on ressent une impression de post-ingénierie, de post-architecture. Nous, jeunes gens modernes et bien connectés, serions non seulement incapables de concevoir un tel système, mais nous ne sommes même pas foutus de le comprendre, même avec l’aide de plusieurs intelligences artificielles Made In Palo Alto. Sans parler de l’incapacité de nos physionomies fragiles à pointer chaque jour pour trier, secouer, et acheminer le charbon lavé…Il ne reste qu’à prendre des photos pour témoigner.
On ressort de ce mastodonte chamboulé de la perte de repères, épuisé physiquement, mais surtout apaisé après sept heures de calme et d’immobilisme, et fasciné d’avoir parcouru de long en large un organisme complexe, assoupi, pas encore naturel mais plus vraiment humain. Pour décrire les usines de Détroit en décrépitude inexorable et leur retour à l’état de nature, Yves Marchand et Romain Meffre, qui les ont photographiées dans leur déclin, évoquent un « ancien corps qui s’est délité, refroidi, rongé de l’intérieur », et décrivent les vestiges de Motor City comme « s’intégrant naturellement au paysage », « un symbole de la décadence dans ce qu’elle a de plus réaliste, donc de plus poignant ». L’exploration de friches industrielles n’est pas une lubie d’amateurs de paint-ball ni une activité pour nostalgiques d’un âge d’or fantasmé. C’est une réflexion sur la fugacité de la trace de l’homme qui perd facilement son combat contre les fougères, un mémento mori gigantesque.
C’est surtout une victoire temporaire contre l’amnésie, l’occasion de prendre conscience de l’écart inouï qui nous sépare d’une époque qui semble avoir été peuplée par une autre espèce et qui est en réalité plus jeune que nos grands-parents.
Du même auteur, vous retrouvez d’autres de ces articles, sur le Courrier de l’architecte :